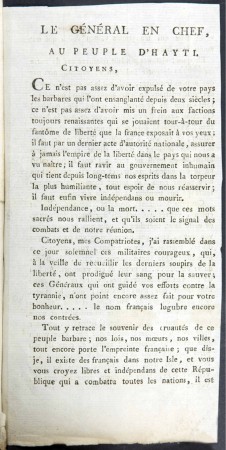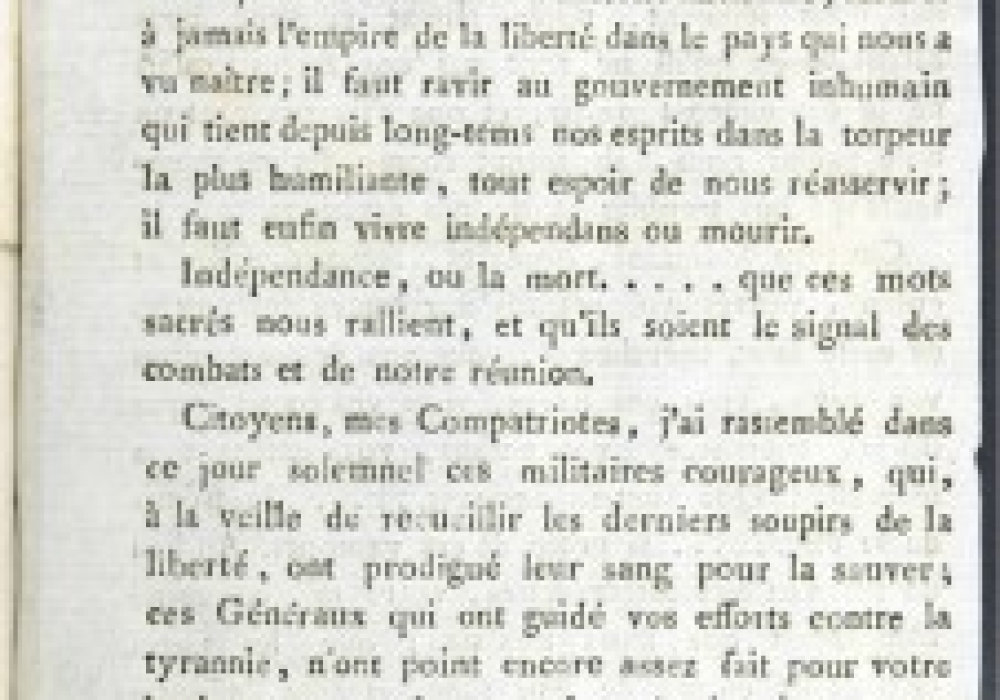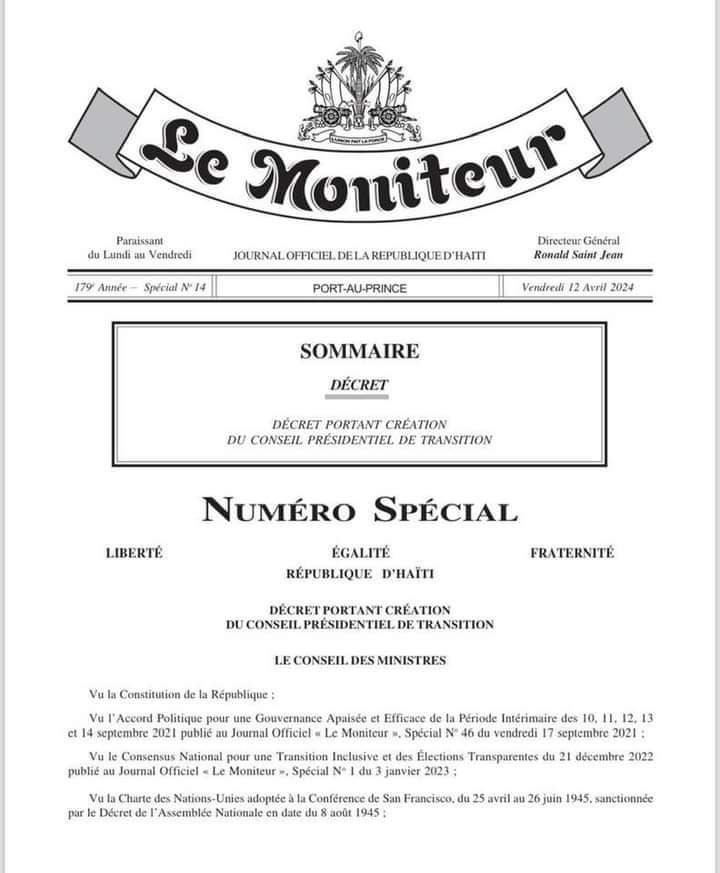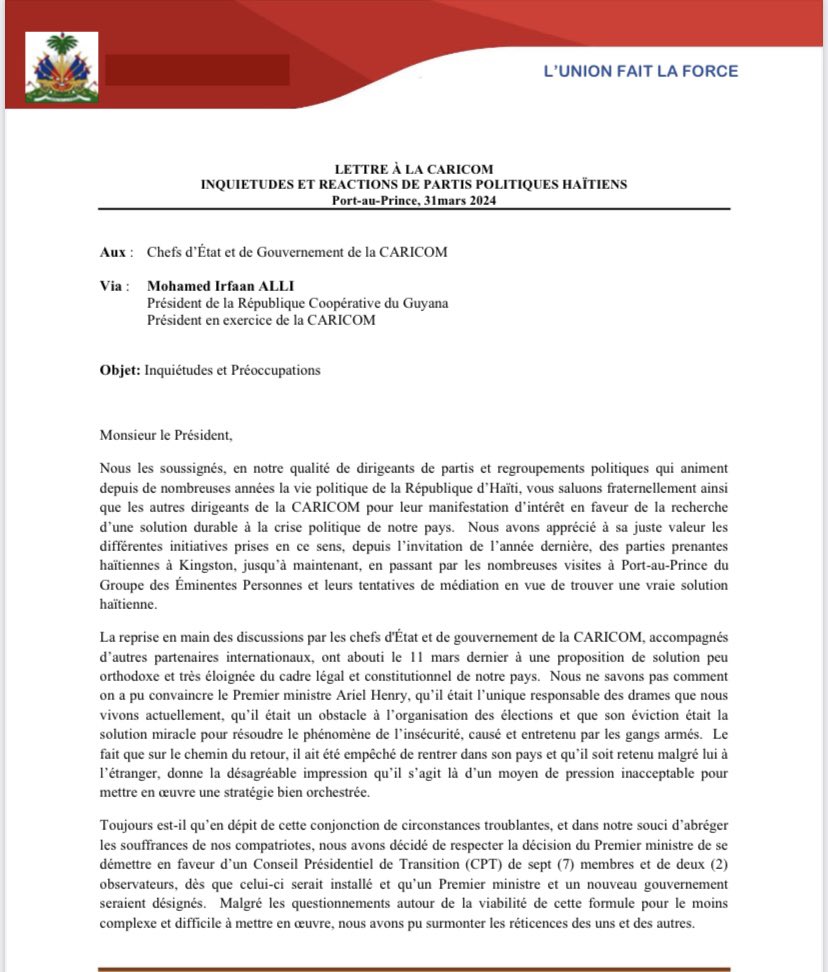La pénalisation de l’avortement en Haïti pousse les femmes vers des centres démunis, et sans prise en charge professionnelle. Ceci les met en grave danger.
Au mois d’août 2021, Gabrielle, journaliste et présentatrice de 26 ans, est tombée enceinte. C’était d’abord une grande joie pour elle, jusqu’à ce que son petit ami et elle se rendent compte qu’ils n’étaient pas prêts pour un enfant.
« On est ensemble depuis deux mois, dit-elle. Il a un enfant et vient tout juste de divorcer. Moi, c’est vrai que j’ai l’âge d’avoir un enfant, mais je ne travaille pas. Mon compagnon m’a demandé d’y réfléchir. Pour finir, je m’y suis résignée, car je ne pourrais pas élever un enfant toute seule. »
À contrecœur, mais impuissante, elle accepte de se rendre dans une clinique spécialisée en avortement, bien que jusqu’à présent l’IVG est interdite dans le pays.
« J’ai passé des jours à pleurer, après que nous avons pris la décision. J’essayais de faire le deuil, mais c’était très difficile pour moi. Le jour où on s’est rendus dans la clinique, je suis restée silencieuse pendant la procédure ; c’était ma façon de dire que je n’étais pas contente », se souvient Gabrielle.
Ils arrivent en milieu de journée devant le bâtiment du centre. Cette petite maison d’un étage voit défiler à toute heure du jour des patientes, seules ou accompagnées. Gabrielle et son compagnon s’y engouffrent.
On la fait monter à l’étage, où l’intervention aura lieu. Gabrielle s’assied parmi d’autres personnes : des filles accompagnées de leurs parents, ou des couples qui ont pris la décision d’arrêter la grossesse, pour des raisons diverses. Elle est seule, son compagnon étant resté au rez-de-chaussée.
Gabrielle était ce jour-là la quinzième patiente de la clinique, alors que la journée était loin d’être terminée. Indécise, angoissée, le cœur battant la chamade jusqu’à la crise de panique, Gabrielle attend son tour. Elle ignorait encore que l’expérience qu’elle allait vivre serait plus douloureuse que ce qu’elle avait imaginé.
Comme à l’abattoir
« Numéro 15 », dit soudainement une voix. Elle met quelques secondes à comprendre qu’on parle d’elle, car elle s’attendait à ce que l’on cite son nom. « Alors qu’il prenait le rendez-vous, mon petit ami m’avait demandé si je voulais donner mon vrai nom. Je le voulais, car après tout c’est moi, c’est mon corps », raconte-t-elle.
Ce « numéro 15 » sorti d’une bouche indifférente et désabusée lui fait mal. « Cela m’a beaucoup affectée, avoue Gabrielle. Je me suis sentie subitement comme un animal qu’on menait à l’abattoir, et qui n’avait pas de nom. Juste un chiffre pour l’identifier. »
Lire aussi: En Haïti, avorter est un crime. Les femmes en paient les frais.
Avant de finalement se décider à procéder à l’IVG dans cette clinique, Gabrielle avait mis au moins deux jours à effectuer des recherches sur le processus. Elle avait compris que celui-ci comprenait plusieurs étapes, et que le jour de l’intervention n’était que le résultat de ces étapes. Mais elle a vite compris que ce ne serait pas le cas ici. Il n’y avait qu’un seul rendez-vous.
Le médecin en charge de la clinique la reçoit et lui pose une seule question : depuis quand avait-elle vu ses règles ? Elle lui répond. « Je m’attendais à bien plus, affirme la jeune femme. Il n’y a eu aucune question sur ma santé, pour savoir si je pourrais supporter l’intervention, aucun bilan de santé. J’étais très angoissée, car je suis anémiée, et je ne sais pas si cela pouvait être un problème. Ils ne m’ont pas non plus posé des questions pour s’assurer que c’est bien ce que je voulais, ou pour m’expliquer ce à quoi il fallait m’attendre. »
Intervention douloureuse
On lui fait signe d’entrer dans un cabinet. Là, une infirmière et son assistant l’attendent. Gabrielle se déshabille dans un coin et enfile une blouse mise à sa disposition. Puis elle se couche sur un fauteuil d’hôpital.
On lui demande d’écarter les jambes, et l’infirmière commence son intervention. Elle introduit un doigt dans son vagin, puis un tube qui lui injecte une sorte de liquide. Gabrielle a atrocement mal. Elle crie et pleure. C’est une intervention sans anesthésie. On ne lui a donné qu’un antalgique, en l’occurrence de l’ibuprofène, qu’elle a bu avec une boisson réhydratante qu’on lui avait conseillé d’apporter.
« Arrêtez de crier ou vous aurez une crise cardiaque », lui dit l’infirmière. Cet avertissement augmente la peur de Gabrielle. Elle essaye de se taire, et d’encaisser la douleur. « Pendant toute l’intervention, et même avant, je voulais seulement prendre mes jambes à mon cou. J’avais mal, à la fois physiquement et psychologiquement. Je voulais partir, mais en même temps je me disais que je devais rester, car comment allais-je faire pour prendre soin de mon enfant ? », se questionne-t-elle.
Gabrielle ne sait pas combien de temps cela a duré ni en quoi l’opération a consisté exactement. Elle n’avait pas la tête pour y penser. Tout ce qu’elle voulait, c’était que cela cesse. « Quand ils ont fini, ils m’ont donné un récipient, au cas où je voulais vomir, raconte Gabrielle. Mais je voulais seulement m’en aller et laisser cet endroit. On m’a prescrit des antidouleurs et des antibiotiques. On est passés les acheter et je suis rentrée chez moi. »
Deux autres jeunes femmes ayant effectué un avortement dans cette clinique rapportent un manque de professionnalisme, une brutalité à peine voilée et une absence de subtilités de la part du personnel.
« Elles viennent tout le temps »
Plusieurs jours après l’intervention, Gabrielle a encore mal au bas-ventre. Elle ne voit pas non plus ses règles. « Ils auraient pu au moins me dire quels effets j’allais ressentir, et combien de temps ils pourraient durer. Ou encore, proposer un suivi psychologique, car avorter n’est pas une décision facile. Mais j’ai dû faire des recherches moi-même pour mieux comprendre », regrette Gabrielle.
Contacté par AyiboPost, le responsable de la clinique admet qu’il y a quelques différences entre la façon de procéder dans le pays, et la façon de faire à l’étranger. « Il est vrai qu’il pourrait y avoir plusieurs rendez-vous, admet-il. Mais nous n’avons pas de psychologues. Le bilan de santé, même s’il n’est pas obligatoire, aurait pu être utile. Mais tout cela n’empêche rien. Être anémiée, avoir déjà avorté, etc., rien de cela ne constitue des contre-indications. »
Lire également: Son conjoint l’a fait passer 8 ans en prison pour avortement. Elle ne savait pas qu’elle était enceinte.
Toutefois, le médecin pense que les conditions ne sont pas si mauvaises, puisque la clinique ne désemplit pas. « Chaque personne est différente, dit-il. Certaines se plaignent et d’autres non. Je peux seulement dire qu’il n’y a pas d’autres cliniques qui soient aussi performantes que la nôtre. D’ailleurs, nous ne sommes pas chers. Avec 3000 ou 4000 gourdes, quelqu’un peut venir, tout dépend d’autres facteurs. Les prix peuvent aller jusqu’à 25 000 gourdes. Mais les patientes sont contentes du service, si bien qu’elles ne cessent de venir ici. »
Au sujet de l’anesthésie, locale ou générale, le propriétaire justifie le choix de ne pas en utiliser : « Entre nous, l’anesthésie peut avoir des effets secondaires sur la patiente, c’est pour cela qu’on préfère s’en passer. On utilise un antalgique juste avant l’intervention pour essayer de diminuer la douleur. C’est mieux ainsi. »
Humaniser les soins
Bien que la grossesse ait été interrompue, Gabrielle ressent encore plusieurs symptômes. « J’ai des malaises, explique-t-elle. J’ai souvent envie d’uriner. Tout cela me déprime et je me pose un tas de questions. Je me sens mal, et je ne sais pas si je pourrai être enceinte à nouveau. Si c’est le cas, je pourrais regretter. »
Même si elle n’était qu’à quelques jours de grossesse, sa mère et des amis avaient deviné qu’elle était enceinte. Si sa maman est au courant de l’IVG, elle n’a pas encore le courage de le dire à ses amis. « Ce n’est pas facile d’affronter le regard des personnes qui savaient, et qui vont poser des questions sur le déroulement de la grossesse. Je ne sais pas s’ils me comprendront, mais j’ai coupé les ponts avec [d] es amis. Depuis l’intervention je reste cloitrée chez moi, je ne sors pas, je ne me nourris presque plus. Déjà que j’habite toute seule. »
Selon la psychologue Nathalie Coicou, ces pensées et comportements sont compréhensibles. « Décider de faire une IVG n’est jamais simple, dit-elle. Surtout s’il y avait le désir d’enfanter. La femme est alors obligée de faire un deuil, et tout dépend de ses croyances, elle peut avoir un fort sentiment de culpabilité. »
La psychologue mentionne également la violence gynécologique, qui peut aussi affecter les femmes dans ces situations. « Parfois, les prestataires de soin se contentent d’effectuer des gestes cliniques, sans comprendre que sur le moment il peut y avoir de grandes émotions qui traversent leurs patientes. »
Nathalie Coicou, qui travaille beaucoup avec des femmes victimes de violence, notamment de viols, estime qu’il y a un vrai besoin d’humaniser les soins dans les hôpitaux du pays. Le patient n’est pas uniquement un corps.
Selon elle, pour aider des personnes qui se trouvent dans la situation de Gabrielle à aller mieux, les relations sociales jouent un grand rôle. Il est important pour les proches de ne pas juger, et d’apporter leur support. « Il ne faut surtout pas lui dire de laisser cela derrière elle, d’avancer. Souvent nous ne laissons pas aux personnes l’occasion de s’exprimer et de verser leur trop-plein d’émotions et de douleur. »
Comme Gabrielle, d’autres femmes qui ont procédé à une IVG peuvent avoir besoin d’un soutien psychologique, clinique ou social, en fonction de leur cas. Toutefois, la pratique de l’avortement reste encore taboue dans la société, surtout que la loi l’interdit.
Le nouveau Code pénal, qui devrait prendre effet dans plusieurs mois encore, apporte cependant des changements, dont la dépénalisation de l’IVG. Gabrielle espère que cela changera certaines pratiques, dans l’intérêt des femmes qui prendraient la décision le plus souvent difficile d’arrêter une grossesse.
Image de couverture: Emin, Tracey. From the Week of Hell ’94. 1995. Tate Britain, London